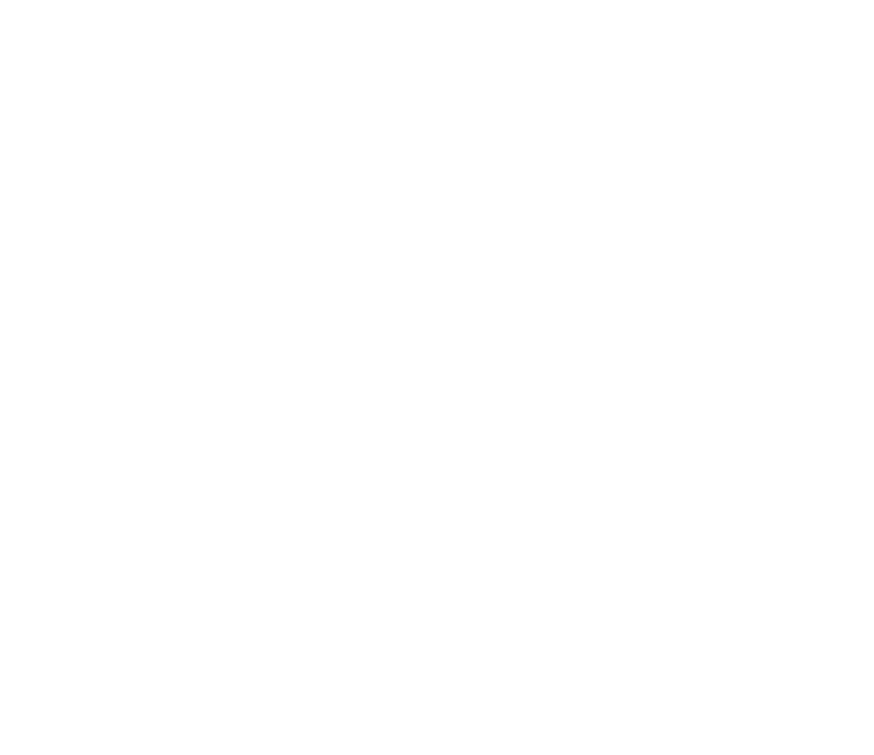La journée qu’organise Bretagne Culture Diversité, en partenariat avec HF Bretagne, le vendredi 15 septembre à Rennes sera clôturée par le concert du trio Muga. Pour nous mettre dans l’ambiance, nous avons rencontré Clara Diez Márquez à l’origine de la création de ce projet artistique. Originaire des Asturies, Clara est une panderetera. Accompagnée au violon par Thomas Felder et à la guitare par Martin Chapron, elle porte le chant des femmes des Asturies sur scène, libérée de tout costume et de toute contrainte !
Clara, comment est né le projet Muga ?
Quand je suis arrivée en Bretagne il y a douze ans, j’avais mon bagage de panderetera et j’ai voulu intégrer ça au panorama culturel breton que je trouvais incroyable. Au début, j’ai créé un groupe de musique à danser avec un répertoire asturien. Mais j’ai assez vite arrêté car je trouvais qu’on me regardait un peu comme un objet exotique. À partir de là, j’ai réfléchi à la manière dont je pouvais mettre mon répertoire et ma voix de femme au cœur de la création. C’est comme ça qu’est né le projet Muga. Muga (prononcez [moura]) en asturien est un terme qui englobe tout ce qui a à voir avec l’humidité : la bruine, la fine pluie mais aussi les choses qui sont causées par l’humidité comme la rouille. Pour moi, ça implique aussi la création de la vie et des choses positives. Et ça sonne bien ! Même si la prononciation fait toujours parler (rires). Pour le répertoire, je me suis appuyée sur le collectage que mon père a réalisé pendant des années. Le but était de pouvoir créer quelque chose à partir de ces chants qui avaient été pendant longtemps intouchables pour moi. Ça a été l’occasion de me réapproprier la pandeireta.
Comment cette réappropriation a-t-elle été perçue ?
La seule fois où je suis allée jouer avec Muga aux Asturies, ça a été un flop monumental. Ça n’a pas forcément été compris. Je me dis juste qu’on n’est pas aux mêmes étapes et j’ai l’espoir que ça évolue car c’est vrai qu’aux Asturies, la culture patriarcale reste très présente. Les hommes qui jouent de la cornemuse, du tambour ou de l’accordéon peuvent modifier la musique, la recréer, et c’est bien qu’ils le fassent. Par contre, les femmes doivent être gardiennes de la tradition la plus « pure » possible et se doivent de respecter ce qu’on leur a transmis. C’est leur rôle. Il n’y en a pas d’autre possible. En tant que panderetera, on m’a toujours dit comment je devais me comporter. On m’a toujours imposé le poids et la responsabilité de la transmission. À l’époque, j’étais très honorée d’être considérée comme l’une des vectrices d’une lignée de transmission mais finalement, j’étais plus un objet qu’autre chose. Le fait de venir vivre en Bretagne m’a permis de prendre de la distance, de me rendre compte que je m’imposais ces choses-là malgré moi. Ce sont mes différentes expériences ici qui m’ont permis de mener une réflexion sur ma pratique de panderetera car sinon, je n’ai pas de littérature sur laquelle m’appuyer. Ça a été très violent pour moi de réaliser que je m’étais pendant longtemps imposée de suivre la tradition au pied de la lettre, de toujours chanter avec un costume du XVIIIe siècle, etc. Je m’autocensurais en fait. Me rendre compte de tout ça a été aussi violent que libérateur finalement. Et qui sait, peut-être qu’un jour, mon travail sera compris.
Tout au long de la journée, nous échangerons sur le « matrimoine ». Qu’est-ce que ce terme t’évoque ? Est-ce que c’est un terme que tu emploies ?
Non, c’est vrai que je ne l’emploie pas. J’utilise le terme patrimoine, même s’il me dérange parfois. Comme je joue de la musique faite par des femmes, chantée par des femmes, transmise par des femmes, je ne me retrouve pas toujours dans ce terme de patrimoine. Je connaissais mal le matrimoine. Je pensais que c’était un néologisme alors que non. En Espagne, on n’utilise pas ce terme-là mais, même en France, je ne l’ai pas beaucoup entendu. Du coup, je me dis que je vais peut-être commencer à parler d’un matrimoine chanté des Asturies. Ça peut être intéressant.
HF Bretagne présentera durant la seconde table-ronde de l’après-midi le diagnostic réalisé chaque année sur la place des femmes dans la sphère culturelle et artistique. Quel regard as-tu sur ta place en tant que femme chanteuse aujourd’hui en Bretagne ?
Depuis que j’ai commencé à faire de la création et que je suis sortie de toutes les cases possibles, j’ai trouvé ma liberté dans le panorama artistique actuel. C’est vrai que j’aurais aimé m’entourer de plus de femmes. Mais même si j’ai toujours travaillé avec des hommes, musiciens, techniciens, je n’ai jamais été confrontée à une situation compliquée ou à des comportements déplacés. Après, il y a toujours le doute qui plane « est-ce que je suis programmée pour répondre à un quota ? » ou « est-ce que je suis programmée parce ce que mon travail correspond à la ligne artistique ? ». Mais bon, j’évite de trop me poser la question. Par contre, je rencontre beaucoup de programmateurs qui n’ont pas forcément conscience de la manière dont leur manque d’intérêt concernant la place des femmes sur scène nuit justement à la présence des femmes sur scène. Il y a vraiment certaines personnes qui n’en ont rien à faire, voire qui sont fières, encore aujourd’hui, de ne pas traiter cette question. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites et qui commencent à payer. On n’a moins besoin de fouiller pour trouver des femmes musiciennes.
Justement, depuis 2022, tu es chargée du contenu pédagogique de l’offre de formation professionnelle de l’association Drom, du cursus de la Kreiz Breizh Akademi (KBA) et des actions territoriales. Est-ce que ce sont des questions qui t’animent dans ton quotidien professionnel ?
On vient de recevoir toutes les candidatures pour la prochaine promotion de KBA et il y a 47% de femmes à avoir postulé. Donc on n’a pas vraiment besoin de faire de la discrimination positive pour avoir un collectif paritaire. D’ailleurs, dans la 9e promotion, il y avait plus de femmes que d’hommes. Mais ça reste des questions qui sont au cœur de notre activité. Du côté des formatrices, c’est pareil. On a un choix très, très large de femmes artistes qui peuvent intervenir avec une qualité de transmission qui n’a rien à envier à celle des hommes.
Quand le programme de la journée du 15 septembre a commencé à circuler, on nous a fait remarquer que le groupe était composé de deux hommes pour une femme, sous-entendu que ça n’était pas paritaire comme choix de groupe pour une journée sur le matrimoine. Qu’est-ce que tu aurais envie de leur répondre ?
Je leur raconterais que, quand Muga a commencé, j’avais refusé d’être au milieu de la scène pour ne pas tomber justement dans le cliché de la chanteuse entourée de ses musiciens. Du coup, j’étais sur le côté. Mais comme j’ai beaucoup de percussions et de bazar qui m’accompagnent sur scène, j’étais finalement cachée. Quand on a commencé à travailler avec d’autres personnes, on nous a dit que l’énergie sur la scène n’était pas du tout équilibrée. On m’a conseillé d’être au centre en tant que personne, en tant que voix et en tant que porteuse du propos. Après plusieurs discussions, ça m’a finalement convaincu. Et c’est vrai qu’en me mettant au centre, les énergies ont complètement changé et je me suis sentie entourée par Thomas et Martin, au sens où ils participent à sublimer le propos. L’habillage et la texture sonores qu’ils apportent mettent en valeur cette voix de femme des Asturies. Je trouve que ça correspond très bien. Et puis, bon, deux hommes et une femme oui, mais c’est moi qui m’occupe de tout. C’est un projet mené par une femme qui chante des chants de femmes et qui mène une réflexion qui a changé sa vie en tant que femme. C’est mon projet et je suis fière de le partager avec tout le monde !
Interview réalisée par Julie Léonard et Héléna Tataruch – juillet 2023
Concert gratuit sur inscription ici